III/ L'impact des organismes vivants sur le recyclage de la terre
Après avoir observé quels sont les impacts chimiques sur le recyclage de la terre, nous allons ici nous intéresser sur la manière dont les organismes vivants interviennent sur celui-ci.
La terre, constituée de matière inerte, contient une grande quantité de matière organique. En effet, de nombreux végétaux et organismes vivants tels que les insectes par exemple se trouvent là-dedans. Cela permet d’enrichir la terre par de la matière organique provenant de cadavres d’animaux, de résidus de végétaux, de déchets organiques… Par ailleurs, l’Homme impacte également sur le recyclage de la terre par ses nombreuses activités comme le rejet de déchets industriels par exemple. Ainsi nous allons donc étudier dans un premier temps l’impact de la matière organique, provenant des animaux et des végétaux, sur le recyclage de la terre et leurs rôles dans la constitution de la terre, puis nous traiterons sur le problème de l’impact de l’Homme sur la terre.
A/ L’impact de la matière organique sur le recyclage de la terre.
Les organismes vivants, qui font partie de l’écosystème, ont des conséquences directes sur la constitution de la terre. En effet, leurs « rejets » permettent de nourrir la terre par de nombreuses manières comme les excréments d’animaux, la dégradation de plantes, …
Ainsi dans un premier temps, nous avons cherché à examiner les animaux présents dans la terre en faisant des prélèvements de différents milieux.

Nous sommes d’abord allés sur un terrain naturel ne présentant à priori pas trop de rejet humain.
Avec l’aide du professeur, nous avons prélevés des échantillons de terre dans différents milieux pour diversifier la nature des insectes présents dans la terre.Nous avons donc prélevé dans trois milieux différents du fait que certains insectes préfèrent des milieux spécifiques (par exemple des milieux boiseux). Nous avons donc prélevé dans un milieu boiseux, dans un milieu riche en racines, et dans un milieu présentant une grande quantité de mousse.




La semaine suivante, nous avons cherché à les identifier à l’aide d’une loupe binoculaire.






Nous avons donc finalement réussi à identifier sept types d’insectes présents dans la terre : (de gauche à droite et de haut en bas)
-
Staphylinidé (coléoptère)
-
Centipèdes
-
Formicidé (fourmi)
-
Porcellionidé (cloporte)
-
Lumbricina (lombric)
-
Aranéide (araignée)
Gastéropode (mollusque)


Puis dans un second temps, nous avons cherché à identifier la matière organique d’origine végétale.
Tout d’abord, nous avons récupéré de la tourbe qui, rappelons-le, est une accumulation de matière organique d’origine essentiellement végétale conservé sur une longue durée.
Après avoir récupéré la tourbe, nous l’avons découpé finement pour que ce soit moins compact.
Après avoir mis la tourbe prédécoupée dans un bécher, nous avons rajouté 20 mL de détergent puis remué pendant 10 min pour détruire les structures cellulaires. On obtient donc une solution (photo ci-contre).

Par la suite, nous avons filtré la solution sur un tamis de 150 µm pour ensuite la centrifuger.
Nous avons ensuite centrifugé le filtrat pendant 6 minutes à 3000 tours/minute.
(Cette vidéo a été filmée à 240 images par seconde et a donc été ralenti de 4 fois.)
Après la centrifugation, nous avons jeté le surnageant (de couleur jaune dans la vidéo ci-contre) et conservé la partie concentrée en matière organique (de couleur marron plus foncée). Puis on a ajouté 10 mL de potasse à la solution.
On a ensuite placé la solution dans un tube à essai pour le mettre au bain-marie pendant 10 minutes (destruction de la matière organique).
Puis, après avoir de nouveau centrifugé la solution durant 5 minutes, nous avons ajouté 2 mL d’eau distillée pour diluer un peu la solution.

On observe finalement le grain de pollen et le xylème d’un végétal au microscope (agrandissement de la photo 2 X400 et des photos 3 et 4 X1000).
Nous avons donc réussi à identifier le pollen et le xylème d’une plante qui constitue la matière organique située dans la tourbe.
Photo

On obtient donc une solution contenant le pollen. Pour l’observation, on rajoute 1 goutte de fuschine sur une lame mince contenant quelques gouttes de la solution pour colorer le pollen. On met ensuite la lamelle par-dessus.
Photo




Tous ces organismes vivants récupérés ci-dessus interviennent sur le recyclage de la terre par leurs rejets de matière organique (excréments, cadavres, …). Nous allons donc ensuite voir comment ces « rejets » peuvent-ils nourrir la terre.
On peut tout d’abord déjà affirmer que c’est la décomposition de la matière organique qui permet de nourrir la terre.

En effet, des déchets organiques non-vivants se déposant sur le sol, sont attaqués par les bactéries qui oxydent la matière organique. Cette réaction chimique produit du CO2, de l’eau (H2O) et de l’énergie sous forme de chaleur. Les vapeurs qui s’échappent d’un tas de fumier en hiver témoignent donc de l’eau et de la montée en température du tas de fumier grâce à l’énergie dégagée par cette réaction.
Avec le temps, la matière organique continue à se décomposer en matière minérale. C’est la minéralisation. Cela restitue donc au sol les éléments nutritifs comme le NH4+, K+, SO42-, … Ces éléments vont être réabsorbés par les végétaux vivants en surface ce qui constitue le cycle.
La matière transformée minéralement, va se retrouver dans l’humus et se transformer en composés humiques par d’autres bactéries. On appelle cela l’humification.

L’humus est de couleur foncée car il est constitué essentiellement de carbone.Il est constitué à la fois de matière minérale et à la fois de matière organique pas entièrement décomposée. Par la suite, les composants de l’humus réagissent avec d’autres cycles comme le cycle du carbone et de l’azote.
Sources d’informations :
B/ L’impact de l’Homme sur la terre
L’être humain depuis le début de l’agriculture a des répercussions sur la constitution de la terre. Celle-ci est davantage accentuée avec l’industrialisation au XVIIIème siècle et de l’agriculture intensive de nos jours. En effet, les rejets humain tel que les déchets industriels, les engrais, … modifient considérablement la constitution de la terre. Nous allons donc voir ici quels sont les conséquences de l’activité humaine sur la terre en étudiant deux cas : l’agriculture intensive de nos jours et les rejets industriels sur la terre.
Tout d’abord nous allons définir qu’est-ce que l’agriculture intensive. L’agriculture intensive ou productiviste « est un système de production agricole caractérisé par l'usage important d'intrants, et cherchant à maximiser la production par rapport aux facteurs de production, qu'il s'agisse de la main d'œuvre, du sol ou des autres moyens de production (matériel, intrants divers) ». « Elle repose sur l'usage optimum d'engrais chimiques, de traitements herbicides, de fongicides, d'insecticides, de régulateurs de croissance, de pesticides... »[fin de citation]. Son but étant d’avoir le rendement et la production la plus efficace possible, elle néglige parfois les impacts qu’elle a sur la terre. Les impacts (pollution) peuvent conduire jusqu’à la stérilisation du sol par les engrais chimiques, pesticides, mais aussi par la déforestation, …

On voit ici que des hectares de terre servent à la production de blé pour le meilleur rendement possible
Cette agriculture a donc des conséquences directes sur la faune et la flore constituant la matière organique présente dans le sol. Les engrais chimiques, le labourage excessif et le désherbage fait disparaître la matière organique et les bactéries du sol et empêche donc denourrir la terre. Les conséquences sont tel que sans alimentation pour les plantes, celles-ci disparaissent ce qui « tue » la terre. Par ailleurs, le lessivage des éléments (transportation vers les nappes phréatiques des ions, argiles, …) trop excessif entraine l’acidification du sol par la perte du calcium, indispensable pour lier l’humus et les argiles. Sans le calcium,l’humus et les argiles se séparent et les argiles partent en suspension dans l’eau.
Tout cela ajouté à l’érosion, entraine la mort du sol. En France, 60% des sols sont frappés par l’érosion.
Cependant, malgré cela il existe des alternatives respectant à la fois l’environnement et la production comme l’agriculture durable ou biologiquequi est de plus en plus valorisée.
Par la suite, nous allons nous intéresser sur les conséquences des rejets industriels sur la terre. Comme pour l’agriculture intensive, les rejets des déchets industriels modifient la structure de la terreconduisant à une modification des propriétés physico-chimique du sol contaminé. Cela aboutit par une diminution de l’activité biologique essentiel la dégradation de la matière organique, qui conduit donc à une stérilisation du sol et de la terre. En effet, la pollution industrielle rejette des métaux parfois lourds comme le mercure, le chrome, le plomb, … et des produits chimiques. Ceux-ci ne sont pas biodégradables dans le sol et contaminent donc la terre indéfiniment. Ces contaminations peuvent tuer littéralement tout l’écosystème comme par exemple en 1953, où on a retrouvé près d’une usine japonaise déversant du mercure dans une baie, des poissons contaminés par le mercure à un taux 500 000 fois supérieure à ceux des eaux de la baie. Ces poissons ensuite consommés, provoquaient des maladies graves chez les habitants (maladie de Minamata).
Plus proche de nous, les déchets quotidiens utilisés sont aussi très peu dégradables.
En effet, on constate que le verre par exemple prend 4000 ans pour être détruit. De simples gestes quotidiens comme recycler ses déchets permettent donc de préserver la terre.
Source schéma :
http://img.over-blog-kiwi.com/0/68/11/73/20140325/ob_072ba9_schema-duree-dechets-428x285.gif
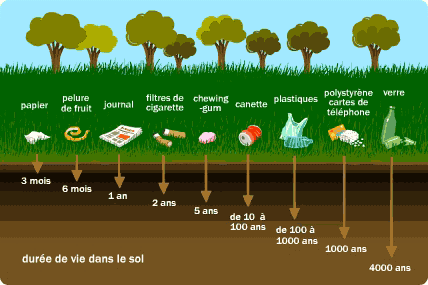
Par ailleurs, il existe également d’autres sources de pollution causant la dégradation du sol. On peut donc conclure en un graphiquemontrant les principales causes.

En conclusion, nous pouvons dire que la terre est animée par de nombreux facteurs assurant son renouvellement. Cependant, d’autres facteurs comme l’Homme peut détruire ce recyclage naturel et automatique de la terre et conduisant ainsi à sa destruction et sa mort.
