I) Le cycle du carbone
Introduction
-
l'histoire de la découverte du carbone
Pour commencer il est important de ne pas confondre le carbone 12, qui est le plus répandu dans notre atmosphère et le carbone14 ainsi que ses isotopes.
Le carbone 12, lui est constitué de 12 nucléons, 6 protons, 6 neutrons et 6 électrons, c'est lui qui est le plus présent dans notre atmosphère (environ 99% du carbone de notre atmosphère). Nous ne savons pas avec précision quand il fut découvert mais se serait environ vers 3750 avant J.C.
noté :

Tandis que le carbone 14 est constitué de 14 nucléons, 6 protons, 8 neutrons et 6 électrons et ne représente que 10% du carbone présent dans notre atmosphère. Il fut découvert le 27février 1940 par les chimistes américains Samuel Ruben et Martin Kamem suite à l'émission de l'hypothèse de son existence par le chercheur Franz Kurie. Il peut être créé en laboratoire en faisant rentré en collision un neutron lent avec de l'azote ainsi il expulse un proton et prend sa place.
noté :

Puis vient les isotopes qui ont les mêmes nombres de protons et d'électrons mais des nombreux de nucléons et de neutrons différents néanmoins ils ont des propriétés chimiques identiques tel le carbone13.
1. Le dioxyde de carbone
L'atmosphère terrestre est constitué d'une multitude de gazs en tous genre tel que :

Comme nous le montre se document, le dioxyde de carbone n’est pas le gaz le plus abondant sur terre néanmoins sa présence reste importante (4e position) et primordial à la vie notamment pour les végétaux qui permettent, à leur tour, la vie des organismes vivants, grâce à la photosynthèse (absorbe le dioxyde de carbone et prélève d’autre éléments (sels minéraux, eau) et le transforme en oxygène nécessaire à la respiration des êtres vivants).
Il est de notre ère de rappeler l’impacte qu’a le dioxyde de carbone sur notre planète. Sans intervention de l’Homme, du co2 se crée mais en quantité équivalente à celle que les différents organismes vivants absorbent, pour produire d’autres éléments tel de l’oxygène. Mais l’Homme dans son avancé technologique et technique a découvert des réservoirs de carbone abondants dans les sols, durant les différentes révolutions industrielles (1er : 1780, 2eme : 1880, 3eme : milieu du XXe siècle) et leurs à trouver une utilité comme à son habitude. Malheureusement ce que l’Homme ignorait c’est que ses besoins allait se multiplié considérablement (par 7 depuis 1800) et que son niveau de vie s’améliorerait et ainsi allait multiplier les consommations et les besoins en pétrole et en charbon. En effet ce n’est pas tant de remonter à la surface le charbon et le pétrole qui est nocif pour la planète mais plutôt de le brûler en très grande quantité, trop grande. Car nous consommons plus que ce que produit la Terre se qui transforme ces énergies en énergies fossiles, car elles sont amenées à disparaitre à cause de notre consommation trop importante.
Lorsque l’on brûle ces matières, de l’énergie est produit mais également du CO2 et en grande quantité ce qui à pour conséquence de renforcer l’ozone et d' emprisonner encore plus de gaz. Le graphe réalisé par le NOAA (=National Océanic and Atmosphéric Administration) en est une preuve, il nous montre que depuis le milieu du XVIIIe siècle la concentration en dioxyde de carbone à pratiquement doubler.
ppmv : est l'abréviation pour dire partie par million en volume. C'est une unité qui permet de quantifié la proportion de gaz carbonique dans l'atmosphère. En somme pour la comprendre il faut se dire que par exemple si nous avons un taux de 380ppmv cela signifie que dans 1 million de gramme d'aire contenue dans un certain volume il y a 380 grammes de gaz carboniques. Les ppmv est un dérivé de ppm (partie par million).
Mais ce n’est pas cela qui nous intéresse, ce qui nous intéresse c’est le carbone. Il est l’élément central de la vie, grâce à ses 4 liaisons covalentes, il peut s’associé à de nombreux autres atomes tels que l’oxygène, l’azote, l’hydrogène et ainsi permet de former les molécules du vivant mais aussi se qui peut le détruire comme notamment le dioxyde de carbone. Comme disait Lavoisier : « Rien ne se perd rien ne se crée, tous se transforme » par conséquent qui utilise le carbone ? Ou se trouve-t-il ? Quel est son cycle ?
Le cycle du carbone
Pour commencer à expliquer le cycle du carbone, il me semble préférable de partir du dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère. Comme dis précédemment le dioxyde de carbone est présent en faible quantité dans notre atmosphère. Cette faible concentration du CO2 est permise par de nombreux organismes de toutes tailles, sur le continent et dans les océans.
1. Dans les océans
Dans les océans ce sont des organismes microscopiques vivants en suspension de l’eau qui permettent la diminution du taux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, le phytoplancton. Le phytoplancton est un terme qui désigne en réalité un ensemble des micro-organismes tel que des cyanobactéries ou encore des micro-algues qui ne peuvent se déplacer d’elles même.
Le phytoplancton est invisible à l’œil nu suite à sa très petite taille (0.2micromètres à 200 micromètres) néanmoins il est quand même observable au satellite :
Comme sur la photographie satellite ci-dessus, le phytoplancton se marque par une couleur bleu-turquoise en forme de grosse spirale car il ne se déplace pas tout seul, ce sont les courants marins qui le porte et ainsi il se déplace en masse. Le phytoplancton est l’un des éléments les plus importants de la terre car il est présent partout, aussi bien dans les océans que dans les mers, les lacs ou encore les puits. A lui seul il réalise plus de la moitié de la production de dioxygène et absorbent une quantité monstrueuse de CO2 soit environ 45 à 50 milliards de tonnes de dioxyde de carbone par an. Il est constitué, comme les végétaux du continent, de chlorophylle qui lui permettent de capter les rayons du soleil et le dioxyde de carbone, il utilise également les sels minéraux dissous dans l’eau (nitrate, silice, phosphate) et des oligo-élements (magnésium, fer…). En somme le phytoplancton se sert des rayons du soleil comme énergie permettant la transformation des sels minéraux, du dioxyde de carbone et des oligo-éléments en dioxygène et en méthane.
Mais le phytoplancton est encore bien plus utile à la nature, effectivement comme nous pouvons le voir dans l’équation chimique au-dessus, la photosynthèse produit du sucre. Se sucre attire des organismes plus gros se nourrissant de ce sucre, le zooplancton. Le zooplancton regroupe quant à lui plus des animaux qui tout comme le phytoplancton se laisse porter par les courants. En revanche le zooplancton peut évoluer, se fortifier et ainsi nager mais dans ce cas il ne fait plus partie du zooplancton mais du necton. Le zooplancton est aussi de très petites tailles (entre 20 micromètre à quelques millimètres) mais lui est visible à l’œil nue et se déplace toujours en banc.
Comme dit précédemment le zooplancton se nourrit du phytoplancton mais à son tour il est mangé par des espèces plus grosses telles que les poissons pélagiques (qui vivent dans les fonds) et benthiques (qui vivent sur les coraux ou qui bougent à l’aide des courants) et ainsi de suite, il sert de nourriture aux plus gros organismes et ainsi ils sont essentielles également à la biodiversité marine.
1. La sédimentation
La sédimentation découle de l’activité planctonique. Etant des organismes vivants ils produisent des excréments (matière carboné) en plus leur duré de vie est extrêmement courte (6 à 8 jours pour les femelles et 2jours pour les males). Toutes ces matières carbonés coulent au fond des océans et ainsi forment comme de la neige qui tombe sur le fond. Progressivement des sédiments et d’autre plancton mort recouvrent le plancton et s’enfouit de plus en plus profondément en multipliant la quantité de plancton au fil du temps. Grâce à de nombreuses conditions géologiques du pétrole se forme.
Voir partie sur la formation du pétrole
Il arrive parfois que le pétrole, quand il ne croise pas de roche-réservoirs ou de roche imperméable, remonte à la surface :
Ces remontés se font majoritairement dans les bassins sédimentaires mais de nos jours nous n’avons plus de remonté naturelle du pétrole ou alors en très faible quantité à cause de son extraction massive par l’Homme, en revanche ce pétrole remonte depuis très longtemps puisqu’il est évoquer dans la bible sous le nom de bitume et dans de nombreux ouvrage de construction navale il est également évoqué sous ce même nom mais pour l’isolation des bateaux, ce n’est qu’en 1859 qu’il est découvert en tant que source d’énergie.
1. L’action de l’Homme
Depuis 1859, le charbon est extrait en masse des sous-sols, notamment durant l’apparition des automobiles, à partir de ce moment l’extraction du pétrole connus un essor considérable qui le plaça en tête des énergies les plus utilisé sur la Terre. Malheureusement cette remonté trop rapide de ce pétrole est extrêmement néfaste pour l’environnement et la planète car en le consommant nous libérons du dioxyde de carbone en trop grande quantité. Nous savons que le pétrole est constitué de plusieurs hydrocarbures dont les pourcentages varient en fonction de sa zone de création, ces hydrocarbures sont constitué en partie d’alcanes (hydrocarbure saturé, ils sont constitués d’atomes de C et de H et ne possèdent pas de liaison multiple C=C ou C≡C. Les alcanes non cycliques ont pour formule brute CnH2n+2.) alors cela nous permet de trouver la formule de combustion des alcanes et vu que le pétrole est constitué également d’alcanes, elle nous permet aussi de trouver l’équation chimique de la combustion du pétrole :
2. Sur les continents
Le pourcentage de terre immergé sur notre planète est bien nettement inférieurs à la surface des océans, d’où le nom de planète bleu mais pendant plusieurs milliers d’années, jusqu’ au XIXème siècle, les scientifiques ne connaissaient absolument pas la présence du plancton et par conséquent ils affirmaient que l’oxygène présent sur la terre était produit par les végétaux du continents. Et non complètement à tors, puisque les végétaux recyclent sensiblement les mêmes quantités de dioxyde de carbone que le plancton (un peu plus= entre 47 et 55 millions de tonnes par an) c’est juste que le plancton, comme dis précédemment est invisible a l’œil nus et donc il fallait attendre l’apparition des microscopes pour pouvoir les observer.
1. La photosynthèse
Tout comme le plancton, les végétaux ont de la chlorophylle qui permet de capter l’énergie du soleil et ainsi alimente la transformation de la photosynthèse.
C’est notamment la chlorophylle qui explique la couleur verte des végétaux ou bien encore du phytoplancton. A l’aide de leurs racines, qui s’orientent vers le bas grâce à la gravité de la Terre, puisent dans le sol des sels minéraux, de l’eau et combinés au dioxyde de carbone et à l’énergie solaire captées par la chlorophylle permet la réaction chimique suivante :
Ainsi est produit du dioxygène. Mais une partie du carbone reste dans les végétaux car il lui sert de comestible en quelque sorte. Mais ce carbone ne reste pas là toute la vie, soit les différentes espèces vivantes mangent ces végétaux et ainsi s’octroi cette matière carboné nécessaire à leur vie qui vas à leur tour être rejeter d’autres manières, soit elles meurent et ce produit alors une nouvelles fois la sédimentation.
2. La sédimentation
Il est fréquent que le sol s’affaisse entrainant avec lui les végétaux qui se situaient au-dessus. Se phénomène d’affaissement arrive notamment le long des côtes ou bien le long de rivières ou cours d’eau suite a l’érosion de la roche. Lorsque cela arrive les végétaux se retrouvent dans l’eau et très vite sont recouvert de sédiments qui forment une surface où les végétaux vont se redévelopper, et plus le temps passe plus la quantité de sédiment augmente enfonçant de plus en plus les végétaux prisonniers. Ce qu’il faut savoir c’est que lorsque ses végétaux se sont retrouvés sous les sédiments ils contenaient encore de l’énergie solaire ainsi que des sels minéraux et suite à l’enfouissement ils se retrouvent bloqués. Plus le temps passe et plus les végétaux s’enfoncent et ainsi plus la pression s’exerçant sur eux augmente ainsi que la chaleur. C’est alors que se forme du charbon.
Pour plus d’information sur la formation du charbon aller voir le chapitre sur la formation du charbon
Les matières constituant le charbon sont extrêmement variés et leur pourcentage sont encore plus variés par conséquents il ne peut exister d’équation chimique du carbone bien définie en revanche nous savons que le charbon est constitué de carbone et par conséquent nous pouvons en déduire son équation de sa combustion :
Mais attention il ne faut pas s’y tromper le charbon n’est en aucun du carbone pur !!! Il est important de noté également qu’il n’y a jamais assez de dioxygène dans le milieu pour que le carbone soit entièrement consommé, en somme le dioxygène est tout le temps le réactif limitant.
3. L’action de l’homme
De nos jours les réserves de charbon sont pratiquement toutes vides suite à leur utilisation massive durant les différentes révolutions industrielles (la première date du XVIIIème siècle) mais leurs utilisations fut relativement assez brève à cause de la découverte du pétrole durant le XXème siècle et parce que le charbon était extrêmement compliqué à récupérer. Effectivement cela demandait d’avoir une main d’œuvre conséquente et d’avoir un gisement composé de charbons supérieurs (dont le pourcentage de carbone était supérieur à 70%). Donc dès la découverte du pétrole qui libérait plus d’énergie lors de sa combustion, le charbon fut petit à petit abandonné ;
De nos jours très peu de mines de charbon sont encore en activité, il ne nous reste plus que les vestiges de son extraction comme les terrils ou les anciennes usines d’extractions. Mais l’Allemagne, elle a fait le choix de revenir au charbon à fin de produire son électricité mais comme dis précédement ce ne fut pas un bon choix. Certe les techniques d’extraction sont plus moderne et ne demande moins d’homme mais les charbon qui sont ressortis sont de piètre qualité et donc apportent peu d’énergie lors de leur combustion.






La couleur verte observable au satellite s’explique par la synthèse soustractive des couleurs. La lumière blanche du soleil arrive sur le phytoplancton qui est principalement constitué d’algues qui ne laisse passer que les longueurs d’ondes situées entre 490nm et 550nm d’où la couleur verte.








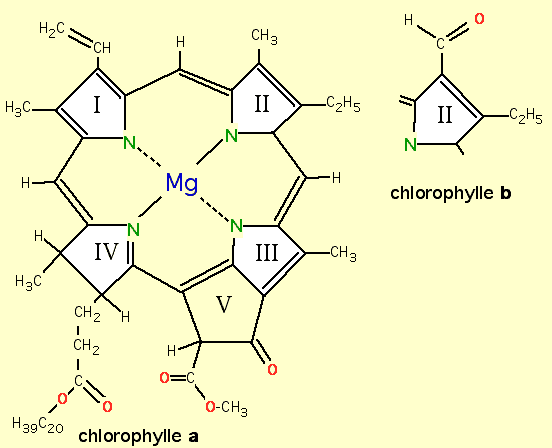







Il est possible de pouvoir observer des photo satellite du phytoplancton d'un même lieu avec des couleurs différentes. Ici nous avons des observations bleues qui peuvent s'expliquer par des intensités lumineuses plus faible comme par exemple durant la saison hivernale et ainsi la photosynthèse se produit en moins grande quantité.

